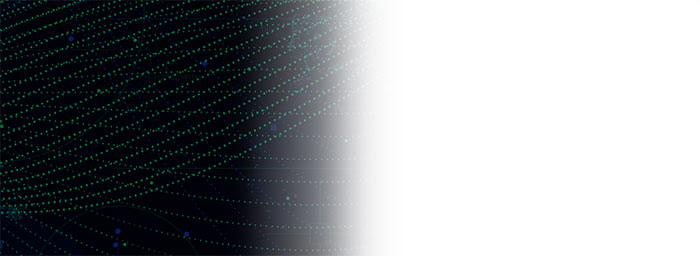Le symposium « Développer la coopération en matière de sécurité entre le Canada et l’ANASE », organisé par les initiatives Canada-ANASE du York Centre for Asian Research, en collaboration avec la Fondation Asie Pacifique du Canada et Affaires mondiales Canada, a réuni des intervenants issus du gouvernement fédéral canadien, de groupes de réflexion, de l’armée canadienne et d’universités canadiennes, ainsi que des ambassadeurs de trois pays d’Asie du Sud-Est pour discuter de la manière de renforcer le partenariat entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) en matière de sécurité.
Les points saillants de la discussion qui s’est tenue à l’Université Carleton d’Ottawa le 13 mai 2024 sont résumés ici.
Les priorités parallèles du Canada et de l’ANASE en Asie du Sud-Est
Il existe une forte synergie entre les priorités du Canada, telles qu’elles sont énoncées dans sa Stratégie pour l’Indo-Pacifique 2022, et les Perspectives de l’ANASE dans l’Indo-Pacifique. Parmi celles-ci figurent la promotion de la paix, de la résilience et de la sécurité régionales, le maintien d’une intégration commerciale et économique ouverte et fondée sur des règles, la promotion de la connectivité et du développement durable, et l’adoption d’une approche inclusive du régionalisme.
Le contexte de la sécurité en Asie du Sud-Est est dynamique et complexe, les États de la région étant confrontés à la concurrence des grandes puissances et aux tensions géopolitiques qui en découlent. Ces questions ne remettent pas seulement en cause la stabilité locale, mais testent également le rôle de chef de file de l’ANASE. Les partenaires de l’ANASE, pour qui la sécurité économique est primordiale, doivent à la fois trouver un équilibre, se protéger et faire front face à ces tensions croissantes.

Mais l’approche de l’ANASE en matière de sécurité est également globale et holistique; parmi les domaines clés dans lesquels elle souhaiterait renforcer sa collaboration figurent la sécurité maritime, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la cybersécurité, l’échange de connaissances et la protection des infrastructures essentielles, ainsi que l’aide humanitaire et l’aide en cas de catastrophe.
Pour s’assurer que ses priorités en Asie du Sud-Est restent alignées sur celles de l’ANASE, le Canada reconnaît qu’il doit adopter une approche nuancée et collaborative. À cet effet, certaines de ses récentes initiatives de coopération avec l’ANASE et ses États membres dans le domaine de la sécurité ont été axées sur les déploiements navals, les interventions en cas de catastrophe, la pêche, la biodiversité, la biosécurité, la cybersécurité, la gestion des frontières et l’affectation de conseillers en défense et d’attachés en cybersécurité supplémentaires canadiens dans les missions diplomatiques canadiennes en Asie du Sud-Est.
Impératifs de sécurité et suprématie du droit en mer de Chine méridionale
La mer de Chine méridionale a été décrite par les participants au symposium comme le pivot dont dépend la sécurité régionale et comme une zone d’une importance économique considérable; en effet, un tiers de l’ensemble du commerce mondial, d’une valeur de plus de 4,6 billions de dollars canadiens par an, transite par la mer de Chine méridionale.
D’un point de vue juridique, la décision rendue en 2016 par le Tribunal de La Haye sur la mer de Chine méridionale en faveur des Philippines était fondée sur des faits et des données scientifiques plutôt que sur des considérations géopolitiques. Bien que des efforts aient été déployés par des membres de l’ANASE pour élaborer un code de conduite régional, l’absence relative de progrès reflète leur capacité limitée à promouvoir un ordre international fondé sur des règles en mer de Chine méridionale.
Afin de contribuer au maintien de la stabilité maritime, les participants ont mentionné que le Canada pourrait prendre des mesures importantes pour s’engager auprès des pays d’Asie du Sud-Est en concluant des accords de défense et des accords de partage d’informations. Le Canada a également renforcé sa présence navale dans la région en déployant trois navires canadiens par an et en participant à des exercices interarmées, soulignant ainsi l’importance d’une plus grande interopérabilité et de partenariats avec ce secteur concernant les technologies de surveillance et l’analyse des données.
Deux initiatives canadiennes non militaires profiteront aux partenaires de l’Asie du Sud-Est : 1) le Fonds commun pour les océans, un engagement de la SIP de plus de 84 millions de dollars canadiens sur cinq ans pour « soutenir la gestion des océans, et renforcer un environnement marin sain », et améliorer « les mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) » dans la région; et 2) le programme canadien de détection des navires clandestins, y compris ses approches et objectifs novateurs en matière de coopération avec l’ANASE dans la lutte contre la pêche INN et la promotion d’un droit international fondé sur des règles dans la mer de Chine méridionale.
En outre, les panélistes ont souligné l’importance des patrouilles d’application de la loi en haute mer, de la surveillance aérienne, de la mise en commun de l’expertise juridique et des mécanismes de signalement pour empêcher la convergence de la criminalité organisée et de l’esclavage humain en mer. Les partenariats entre les acteurs étatiques et non étatiques peuvent accroître la transparence dans le domaine de la pêche INN, par exemple en analysant les informations sur les pêcheries fournies par les satellites. Une collaboration plus étroite avec le secteur de la défense pourrait faire progresser la coopération entre le Canada et l’ANASE en matière de sécurité maritime, par exemple dans le renforcement des capacités liées au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance.
Quelques pistes pour renforcer l’« empreinte invisible » du Canada en Asie du Sud-Est
Pour s’engager en Asie du Sud-Est, il ne suffit pas de fournir de l’aide; il faut écouter les voix de l’ANASE afin de s’assurer que les deux parties bénéficient d’une coopération bien calibrée, y compris sur les questions stratégiques et économiques. Par exemple, le Canada pourrait offrir des bourses à des Asiatiques du Sud-Est afin d’aider la région à renforcer ses capacités dans des domaines tels que les sciences de la mer et le droit maritime. Le Canada apporterait ainsi une contribution positive aux questions liées à la mer de Chine méridionale.
En outre, les pays de l’ANASE reçoivent des signaux contradictoires au sujet du Canada, percevant certaines choses dans les déclarations du gouvernement et d’autres dans les commentaires des médias. Lorsque le pays mettra en œuvre sa Stratégie, les États d’Asie du Sud-Est surveilleront son engagement sincère et durable, sa proactivité et sa sensibilité à la mentalité de l’ANASE orientée vers le consensus.
Le Canada ne doit pas se montrer trop attaché à son aspiration à rejoindre la réunion élargie des ministres de la Défense de l’ANASE; il doit plutôt tirer parti, dans la mesure du possible, de son statut d’observateur au sein de cet organe (s’il lui est accordé) et de ses groupes de travail, pour rechercher d’autres plateformes lui permettant de s’engager avec l’ANASE dans le domaine de la sécurité. Cela pourrait passer par l’examen de la manière dont les organes trilatéraux et mini-latéraux pourraient contribuer à la coopération régionale en matière de sécurité. Un panéliste a également proposé que le Canada envisage de nommer un envoyé chargé de la sécurité dans la région indo-pacifique.
Le Canada devrait également se démarquer des positions des États-Unis. Par exemple, le Canada, contrairement aux États-Unis, est membre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), dont font également partie quatre membres de l’ANASE (Brunei, Malaisie, Singapour et Vietnam) et d’autres (Indonésie et Thaïlande) qui ont fait part de leur intérêt à y adhérer.
Il a également été suggéré que le Canada s’associe à d’autres pays en dehors de la région (comme le Japon et la Corée du Sud) qui sont en train de consolider leur engagement avec l’Asie du Sud-Est dans les domaines du commerce, de la technologie et de la sécurité, et qui le font pour satisfaire aux intérêts de l’Asie du Sud-Est.
En conclusion, le symposium a mis en lumière le rôle essentiel d’une coopération renforcée entre le Canada et l’ANASE pour promouvoir la sécurité et la suprématie du droit dans la région indo-pacifique. L’alignement de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’Indo-Pacifique du Canada et des Perspectives de l’ASEAN dans l’Indo-Pacifique – ainsi que d’autres moyens de promouvoir une plus grande stabilité dans la mer de Chine méridionale – peut ouvrir de nouvelles voies pour la croissance et la collaboration. Les participants ont apprécié la possibilité de comparer et de confronter les points de vue de représentants de différents ministères, de chercheurs et de trois ambassadeurs d’Asie du Sud-Est. Ils ont accueilli favorablement la perspective d’un deuxième symposium de ce type sur la coopération en matière de sécurité entre le Canada et l’ANASE.
- L’autrice, Julia Bentley, a rédigé ce rapport de synthèse en consultation avec Julie Nguyen, Ph. D., présidente des initiatives Canada-ANASE, York Centre for Asian Research à la York University, et cofondatrice et directrice du Conseil commercial Canada-Vietnam. Zhi Ming Sim (doctorante en sciences politiques, York University) et Je Ho Cho (étudiant à la maîtrise en affaires internationales, Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University) ont contribué à ce rapport.