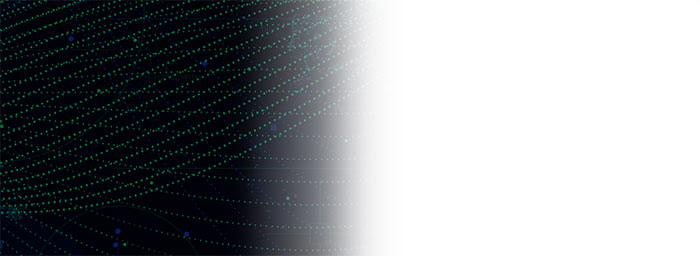À retenir
Le 20 mai, Lai Ching-te a prêté serment en tant que président de Taïwan, après une troisième victoire électorale consécutive sans précédent de son parti, le Parti démocrate progressiste (PDP), en janvier. Dans son discours d’investiture, M. Lai a affirmé qu’il maintiendrait une identité taïwanaise distincte de la Chine et a fait part de son intention de préserver la stabilité de part et d’autre du détroit de Taïwan tout en renforçant les liens avec les alliés démocratiques.
Le 23 mai, la Chine a organisé des exercices militaires autour de l’île, les qualifiant de « sanctions sévères » à la suite des propos du président Lai et mettant en garde les « forces extérieures » contre l’« ingérence et la provocation ». M. Lai, dont le parti est minoritaire au sein du Yuan législatif de Taïwan, doit faire face à un parlement de plus en plus divisé. L’opposition, une coalition de facto du Kuomintang (KMT) et du Parti populaire taïwanais (TPP), a tenté de faire adopter des lois qui limiteraient le pouvoir présidentiel, entravant ainsi la capacité de M. Lai à mettre en œuvre sa politique.
En bref
- Dans sa déclaration d’investiture, M. Lai a présenté les relations entre la Chine et Taïwan comme une question d’intérêt international. Beijing, qui considère ces relations comme relevant des affaires internes, s’est opposée à cette formulation. Tout en s’engageant à maintenir le « statu quo » avec la Chine, M. Lai a exhorté Beijing à apaiser les craintes internationales relatives à une guerre en cessant ses intimidations politiques et militaires à l’égard de Taïwan et en « choisissant le dialogue plutôt que la confrontation ».
- Afin de préserver le rôle central de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement mondial, M. Lai s’est également engagé à renforcer les défenses de l’île, à approfondir les partenariats commerciaux avec d’autres démocraties et à développer des secteurs clés, tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la sécurité et la surveillance, ainsi que les communications de nouvelle génération.
- Des invités internationaux ont assisté à la cérémonie d’assermentation de M. Lai, notamment d’anciens fonctionnaires américains, des législateurs du Canada, du Japon et de l’Allemagne, ainsi que des dirigeants des 12 pays avec lesquels Taïwan entretient des relations diplomatiques officielles.
- La délégation canadienne de 11 personnes était dirigée par la députée libérale Judy Sgro. Le président Lai les a accueillis en exprimant l’espoir que le Canada, qui préside actuellement la Commission de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), soutiendrait la demande d’adhésion de Taïwan à l’accord commercial.
- En ce qui concerne les relations entre la Chine et Taïwan et les relations extérieures, M. Lai poursuivra la « diplomatie indéfectible » de Mme Tsai, qui consiste à cultiver les relations non officielles de Taïwan et à renforcer les liens économiques avec les démocraties occidentales sur la base de valeurs démocratiques communes, tout en s’efforçant de gérer avec prudence les relations avec Beijing. Cette continuité est attestée par le fait que M. Lai a maintenu en poste des fonctionnaires clés tels que l’ancien ministre des Affaires étrangères Joseph Wu, qui dirige désormais le Conseil national de sécurité de Taïwan.
Conséquences
- Un apaisement des tensions entre les deux rives du détroit est peu probable. Beijing perçoit depuis longtemps le PDP comme un parti séparatiste qui rejette le principe d’une seule Chine. Elle considère également M. Lai comme un « indépendantiste ». Par rapport à celui de son prédécesseur, le discours d’investiture de M. Lai a été plus ferme quant à la souveraineté de Taïwan, désignant Beijing sous le nom de « Chine », terme que Mme Tsai évitait au profit de l’« autre côté du détroit » ou des « autorités de Beijing ». Le président Lai a également omis toute référence au « consensus de 1992 », un accord entre Beijing et le KMT, alors au pouvoir, selon lequel il n’existe qu’une seule Chine, chaque partie étant autorisée à en donner sa propre interprétation. La Chine considère l’adhésion au consensus de 1992 comme une condition préalable au dialogue entre les deux rives du détroit. Elle a rompu tout engagement officiel de haut niveau avec Taipei après l’accession de Mme Tsai à la présidence en 2016.
- Le président Lai est confronté à des vents contraires sur le plan législatif. Depuis le début de la session parlementaire en février, les partis d’opposition ont bloqué au moins 15 motions du PDP, y compris une proposition d’amendement exigeant que les législateurs obtiennent l’approbation du gouvernement avant de se rendre en Chine. Les tensions ont atteint leur paroxysme le 17 mai, lorsqu’une bagarre a éclaté en Chambre après que l’opposition a tenté de contourner les procédures d’examen habituelles pour faire passer un ensemble de réformes accordant plus de pouvoir au parlement. Un tel blocage législatif pourrait limiter considérablement la capacité de M. Lai à mettre en œuvre une politique, notamment en matière de défense nationale et de relations entre la Chine et Taïwan.
- M. Lai s’efforcera de renforcer les liens avec ses principaux partenaires, en particulier les États-Unis et le Japon. Les États-Unis ont déjà manifesté leur soutien à M. Lai. Le président américain Joe Biden a envoyé une délégation non officielle dont faisait partie Richard Armitage, ancien secrétaire d’État adjoint, pour assister à la cérémonie d’investiture. La délégation a réaffirmé au président Lai que l’engagement des États-Unis à l’égard de Taïwan était « profond et indéfectible ». Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également félicité M. Lai, promettant une collaboration continue sur des priorités communes.
Le Japon a également fait part de son soutien sans faille en envoyant sa plus importante délégation à l’inauguration du président Lai. Conduite par des membres du parti libéral démocrate au pouvoir, la délégation a plaidé en faveur d’une coopération plus étroite avec Taïwan. Elle a notamment appelé à des pourparlers trilatéraux avec les États-Unis en matière de sécurité, soutenu l’adhésion de Taïwan à l’Organisation mondiale de la Santé et appuyé sa candidature à l’adhésion au PTPGP.
Prochaines étapes
1. Les divisions parlementaires risquent de provoquer des troubles généralisés
Des manifestations de masse ont secoué Taipei le 21 mai, des dizaines de milliers de citoyens envahissant les rues devant le parlement pour protester contre la législation controversée du KMT et du TPP. Les critiques accusent le corps législatif dirigé par l’opposition de saper les normes démocratiques de Taïwan.
Jusqu’à présent, l’opposition n’a pas tenu compte de la réaction du public, accélérant les procédures législatives qu’elle privilégie et avançant d’autres projets de loi controversés en deuxième lecture. Le KMT a défendu ses actions en déclarant que « la réforme [du parlement] est inévitable ».
2. Renforcer la coopération entre le Canada et Taïwan
Deux objectifs particulièrement évoqués par M. Lai – parvenir à la carboneutralité et faire de l’île une puissance en matière d’intelligence artificielle – constituent des pistes prometteuses pour renforcer la coopération avec le Canada. L’expertise naissante de ce dernier dans le domaine de l’IA, en particulier en recherche et développement, s’aligne sur les capacités de fabrication de matériel informatique de Taïwan. Taïwan peut également tirer parti du leadership du Canada dans le domaine des technologies propres, notamment l’hydrogène vert.
• Rédaction : Vina Nadjibulla, Xiaoting (Maya) Liu, Erin Williams et Ted Fraser. Design : Chloe Fenemore. Image : An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images