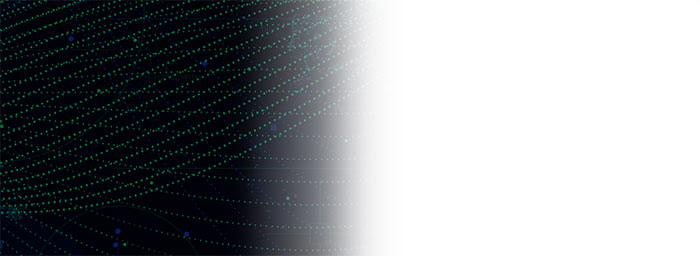Auparavant connues pour être les piliers de l'efficacité économique et de la mondialisation, les chaînes d'approvisionnement sont devenues l'arène des confrontations géopolitiques, où des pays exploitent le pouvoir de segments critiques comme instrument stratégique de négociation. Une récente illustration de ce phénomène est représentée par les tarifs douaniers imposés par Donald Trump contre le Canada. Depuis son investiture il y a quelques semaines, le président américain a compromis l'accès à la dernière phase de plusieurs chaînes d'approvisionnement canadiennes, notamment au vaste marché des consommateurs américains, en utilisant cet outil comme moyen de pression pour inciter Ottawa à renforcer sa sécurité militaire aux frontières. D'autres demandes sont attendues prochainement. Pour le Canada, cet épisode devrait provoquer une prise de conscience brutale. La situation expose les vulnérabilités d'un monde interconnecté et met en lumière l'urgence d'élaborer une stratégie tournée vers l'avenir pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement.
Ce phénomène, que les experts décrivent comme l'instrumentalisation des chaînes d'approvisionnement, reflète une nouvelle tendance sombre sous-jacente à la mondialisation. Dans un monde interconnecté, les entreprises dépendent fortement des intrants étrangers pour produire biens et services. Dans la plupart des cas, cette interdépendance constitue une force bénéfique pour tous. Les entreprises intègrent des composants de haute qualité et à faible coût dans leurs lignes de production tout en renforçant leur flexicurité — un mélange de flexibilité et de sécurité — en s'approvisionnant auprès de fournisseurs répartis dans différents pays. Cependant, ce système n'est pas sans lacunes. Les goulets d'étranglement — ces étapes clés dans une chaîne d'approvisionnement où un seul pays ou fournisseur détient presque un monopole avec peu ou pas d'alternatives viables — représentent un risque majeur. Dans certains cas, le pays dominant peut instrumentaliser ces goulets comme arme politique, menaçant d'en interrompre l'accès et envoyant des ondes de choc à travers toute la chaîne d'approvisionnement.
De récents exemples illustrent la prévalence croissante de cette tactique. En 2019, le Japon a instrumentalisé sa domination sur les produits chimiques de haute technologie pour sanctionner la Corée du Sud à la suite d’un différend politique, en restreignant l’accès à des matériaux critiques indispensables à la production de semi-conducteurs et d’écrans d’affichage. De manière similaire, en 2020, les États-Unis ont exploité leur contrôle sur les designs avancés de puces électroniques pour empêcher des entreprises étrangères de vendre des semi-conducteurs et des équipements intégrant des technologies américaines aux sociétés figurant sur la « Entity List » du département du Commerce américain. L’objectif était clair : consolider la domination américaine dans le secteur des semi-conducteurs tout en freinant les ambitions chinoises en matière de fabrication de puces avancées.
Les menaces d’imposition de tarifs douaniers contre le Canada, parmi d’autres pays, illustrent parfaitement les principes du manuel trumpien sur l’exploitation des goulets d’étranglement. Par exemple, lorsque la Colombie a refusé d’accueillir un avion militaire transportant des ressortissants colombiens expulsés des États-Unis, Donald Trump a répliqué en menaçant de restreindre l’accès de la Colombie au marché américain, une destination critique pour plusieurs chaînes d’approvisionnement colombiennes. Cette menace s’est matérialisée par des tarifs douaniers et des sanctions économiques. Une tactique similaire a été utilisée contre le Canada, où Trump s’est contenté d’imposer des tarifs généralisés de 25 % sur les importations canadiennes (et 10 % sur les produits énergétiques) après que le Premier ministre Trudeau eut promis d’investir dans la sécurité frontalière. Ce qui différencie la stratégie Trump des autres est son étendue et sa profondeur sur le segment consommateur : plutôt que de cibler une industrie spécifique, il a instrumentalisé l'outil aiguisé qu'est le marché de consommation américain, mettant ainsi de la pression à tous les niveaux pour obtenir des concessions.
Heureusement, le Canada ne manque pas de leviers stratégiques face à ces pressions économiques des États-Unis. Bien que Trump puisse prétendre que le Canada a peu à offrir, la réalité est tout autre. Le Canada contrôle des points clés des chaînes d'approvisionnement, notamment des segments où sa domination le rend indispensable. Les minéraux critiques, les ressources énergétiques, les technologies médicales et les composants automobiles ne sont qu'une partie des produits dont les États-Unis ne peuvent se passer. Ces segments ne sont pas seulement des avantages économiques, ils constituent également des cartes maîtresses dans son arsenal stratégique. En s'appuyant sur ces points forts, le Canada renforce sa résilience économique tout en consolidant son positionnement sur le marché mondial.
De surcroît, le Canada possède un atout supplémentaire : la diversification. En élargissant ses liens économiques avec d'autres pays, le Canada menace d'affaiblir les efforts des États-Unis pour établir une « forteresse nord-américaine », une finalité que le voisin du sud souhaiterait éviter, tout en limitant sa vulnérabilité aux pressions américaines. D'autres pays, notamment en Asie-Pacifique, qui font face à des pressions similaires de la part des États-Unis, pourraient se montrer plus ouverts à la collaboration, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour le Canada. Le Canada devrait saisir ce moment charnière pour élaborer une stratégie concrète de diversification.
Au final, le Canada pourrait également recentrer son attention à l'intérieur de ses frontières. En investissant dans la suppression des barrières commerciales internes et en modernisant les infrastructures de transport, le pays pourrait faciliter les opérations commerciales pour les entreprises canadiennes, renforcer les marchés locaux et réduire sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires étrangers. Une économie nationale mieux intégrée offrirait aux entreprises des alternatives viables, rendant le Canada moins vulnérable aux pressions exercées par d'autres pays via l’instrumentalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Cela dit, il serait contre-productif pour le Canada de se retirer complètement des chaînes d'approvisionnement globales. La pierre angulaire de toute stratégie canadienne en matière de chaînes d'approvisionnement devrait être un investissement et un soutien accru à la création de réseaux internationaux ouverts, diversifiés, fiables et socialement responsables. Pour la majorité des produits, la nature mondialisée des chaînes d'approvisionnement constitue un atout indéniable pour la prospérité économique du pays. Afin d'optimiser ces avantages, il serait essentiel d'entreprendre des actions concrètes : faciliter le commerce à l'intérieur et à l'extérieur des frontières canadiennes, moderniser les infrastructures de transport vieillissantes et élaborer des normes solides de traçabilité, et améliorer la capacité du Canada à cartographier les chaînes d'approvisionnement mondiales.